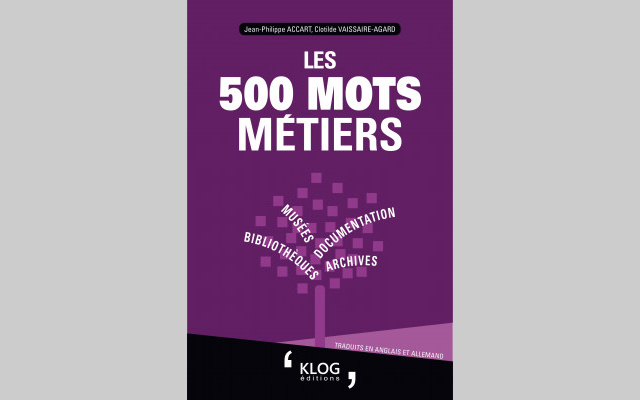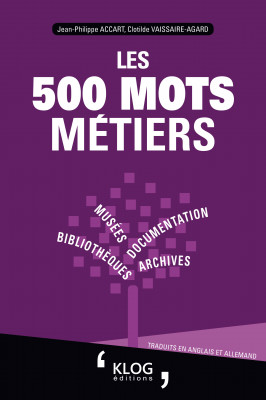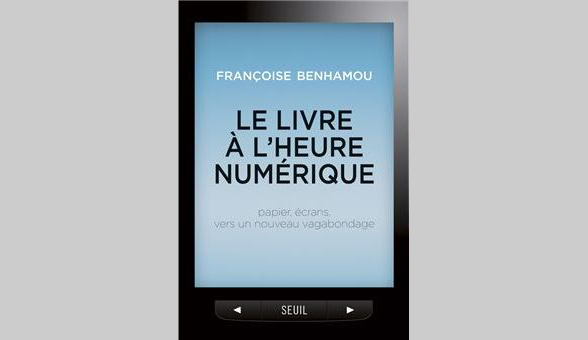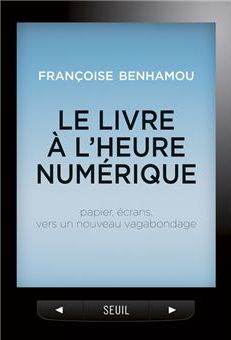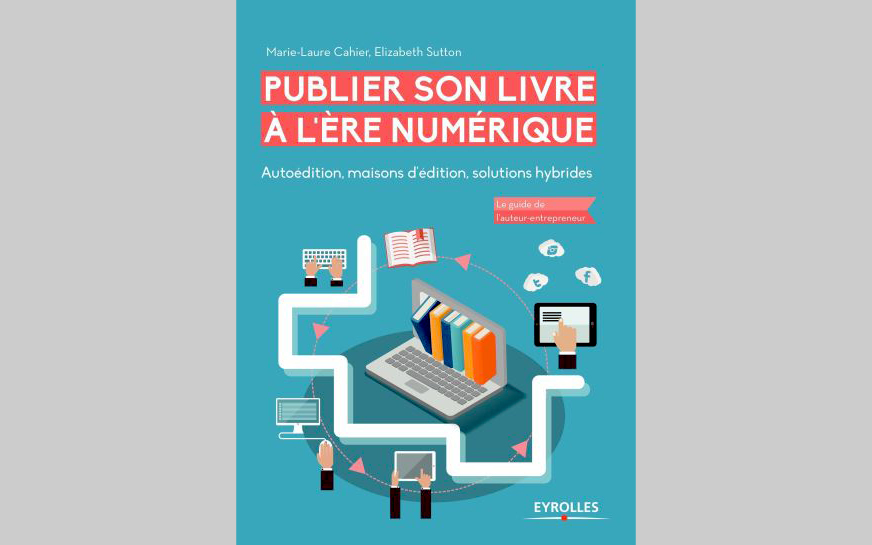
Publier son livre à l’ère numérique
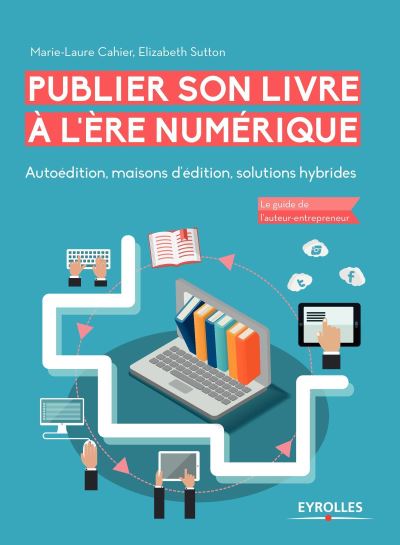
Marie-Laure Cahier et Elizabeth Sutton, Publier son livre à l’ère numérique, 2016
Ecrire un livre implique encore l’idée de prendre du recul sur le sujet que l’on traite, de dresser l’état de l’art sur une question, appelé à faire date. Même si c’est de moins en moins le cas, et même si à coup sûr de nouveaux ouvrages paraîtront sur le sujet, le livre de Marie-Laure Cahier et Elizabeth Sutton, Publier son livre à l’ère numérique, sorti il y a bientôt une année, est toujours d’actualité.
Témoignages
Le recours à de très nombreux témoignages est un des mérites du livre. Ces expériences s’enrichissent mutuellement. Elles ne se limitent pas d’ailleurs à l’édition numérique aborde aussi globalement la question de l’auto-édition. Il s’agit d’une exploration pragmatique des stratégies de publication offertes, où le choix d’un support peut être une question d’affinité, mais surtout d’opportunité.
On retrouve dans ces pages une figure connue, celle de l’écrivain François Bon, « star » incontestée des nouvelles formes éditoriales et défricheur du numérique au long cours (p. 10-13). Ce qui ne l’empêche pas d’être aussi publié par de grands éditeurs parisiens.
Le récit de Daniel Ichbiah (p. 77-78) illustre de façon emblématique une des recommandations fortes de ce livre: l’autonomisation de l’auteur. Apprenant incidemment en avril 2014 que son ouvrage sur les Rolling Stones était épuisé, Daniel Ichbiah demande à son éditeur de le réimprimer en prévision de la venue du groupe à Paris agendé deux mois plus tard: refus de l’éditeur et impossibilité de briser le contrat pour reprendre le contrôle de la diffusion dans un délai si court. Le spécialiste décide alors d’autoéditer sur la plate-forme d’Amazon Les Chansons des Rolling Stones, un livre réalisé en un temps record et composé de différents textes écrits durant les années précédentes. Le jour du concert – et grâce à une promotion parfaitement professionnelle – le livre est devenu le numéro un des ventes d’Amazon. Il se vend aujourd’hui à 3.80 € en version Kindle et 9.90 € en papier (impression à la demande).
Cette aventure illustre bien un fossé qui se creuse: d’un côté la lenteur des éditeurs traditionnels, de l’autre la souplesse des plates-formes de publication en ligne. Est-ce à dire que les éditeurs traditionnels sont inefficaces? Ce serait largement exagéré; ils ont simplement conservé des processus qui fonctionnaient dans un autre paradigme. Et même s’ils ont raccourci leur circuit de production pour pouvoir sortir des livres plus proches de l’actualité (mais également plus éphémères) celui-ci reste bien trop long au regard du numérique.
La démarche de Daniel Ichbiah montre clairement la nouvelle opportunité que représente l’édition numérique. Sans la plate-forme d’Amazon, l’auteur n’aurait pas été en mesure de produire son livre et les fans n’auraient rien acheté ! L’auteur n’aurait pu alors que maugréer contre la courte vue de son éditeur.
Ces histoires de succès électroniques figurent en bonne place. Mais les deux auteures ne manquent pas de rappeler aux amateurs candides la loi impitoyable du numérique: la plupart des livres autoédités sont noyés dans une masse qui les rend invisibles. L’audience n’arrive pas par miracle, mais demande a minima une stratégie réfléchie de promotion. « Les auteurs sont en général nombreux à pointer les défaillances des éditeurs traditionnels en matière de promotion et de communication. Mais vous découvrirez vite qu’il n’est guère plus facile pour un auteur indépendant de réussir le lancement de son ouvrage. » (p. 123).
Typologie
Le livre présente une galerie de portraits d’auteurs types, selon leur affinité avec le numérique, leur relation avec leur éditeur, leur envie de tester de nouvelles formes de publication, ou encore leur capacité à produire tout seuls leurs publications. Cette dernière catégorie d’auteurs est particulièrement ciblée ici. La couverture porte d’ailleurs en sous-titre « Le guide de l’auteur-entrepreneur », allusion à ce statut emblématique de la nouvelle économie.
S’ensuit l’énumération de cinq raisons pour ne pas devenir un auteur-entrepreneur: la pléthore de manuscrits et de candidats à la publication, la faiblesse du marché du livre numérique en France, le désir de devenir un auteur à succès, une allergie à utiliser des outils numériques ou encore le manque de temps. A quoi répondent dans le chapitre suivant cinq raisons pour franchir au contraire le pas: s’affranchir du filtre d’entrée constitué par les éditeurs, afficher volontairement une démarche alternative militante, améliorer son revenu, contrevenir aux défaillances des éditeurs, créer sa propre communauté de lecteurs.
Puis le livre envisage méthodiquement les questions pratiques: les acteurs de l’autoédition (plates-formes d’autoédition, diffuseurs-agrégateurs, consultants), la fixation du prix de vente, la fabrication numérique et bien sûr la promotion, qui va miser à fond sur les réseaux sociaux, le contact avec les journalistes. Le livre se termine sur les promesses de rémunération que l’on peut attendre (« Allez-vous gagner de l’argent? ») et la question du statut fiscal le plus approprié. Concernant la rémunération, l’auteur indépendant gagnera plus pour un ebook vendu que pour un exemplaire imprimé. Mais le volume des ventes est bien plus aléatoire. « Pour notre part, nous restons sur l’idée de base qu’il se vend toujours beaucoup plus de livres imprimés que d’ebooks. » (p. 148).
Des univers étanches
Comme dans d’autres domaines bousculés par l’économie numérique, le monde de l’édition aujourd’hui s’apparente à une querelle des anciens et des modernes. Les premiers seraient en perte de vitesse, alors que les seconds n’ont pas encore réalisés leurs promesses. Il en résulte qu’il est difficile de miser sur les uns comme sur les autres. Cette opposition est clairement assumée par les deux spécialistes, qui ont une connaissance intime du secteur.
Les anciens, les éditeurs traditionnels, travaillent dans des temps longs, peu réactifs, rémunérant peu leurs auteurs (en pourcentage). L’autoédition « se développe parallèlement à celui de l’édition traditionnelle, comme un monde à part. Les vecteurs de communication et les relais d’information développés en autoédition ne recoupent pas (encore) ceux de l’édition traditionnelle: le libraire et le journaliste, cibles prioritaires de l’édition classique, sont en autoédition moins influents que le blogueur spécialisé, la plateforme de distribution et, bien évidemment, les lecteurs. » (p. 125).
Empowerment
Autonomisation, autoentrepreneriat, empowerment… Nous ne cessons d’entendre ces mots d’ordre en ces années 2010 bousculées par la numérisation de l’économie. C’est le conseil que l’on donne aux jeunes comme un mantra: prends ton destin à bras le corps, romps avec les voies toutes tracées. C’est un des aspects d’une société toujours plus individualiste.
Si le concept d’auto-édition n’exclut pas le recours à d’autres intervenants (agents, relais, blogueurs, développeurs, conseillers…) c’est bien l’auteur et lui seul qui a son sort entre les mains. Cela correspond bien au parcours des auteures de Publier son livre à l’ére numérique, devenues indépendantes et affranchies des éditeurs: Elizabeth Sutton est co-fondatrice d’un site d’informations sur les ebooks (idboox.com) et Marie-Laure Cahier a créé Cahier&Co, une entreprise de conseil et d’accompagnement éditorial.