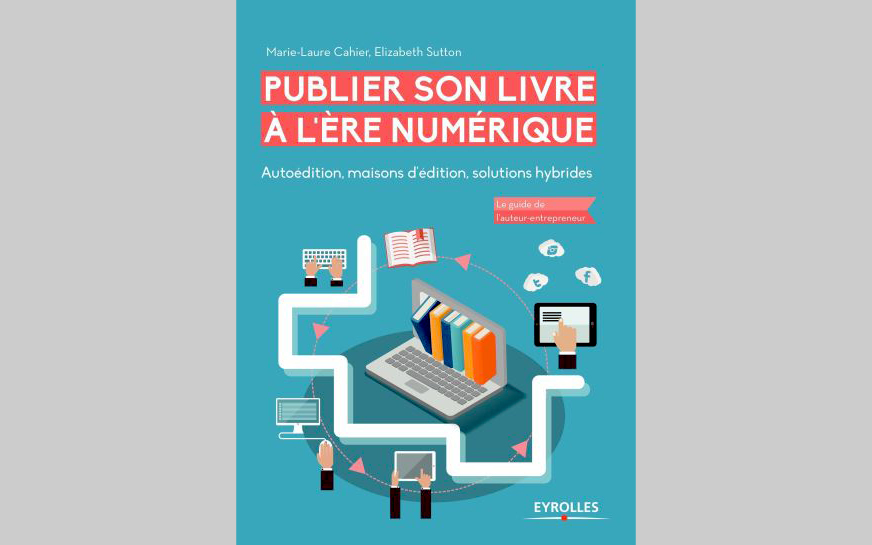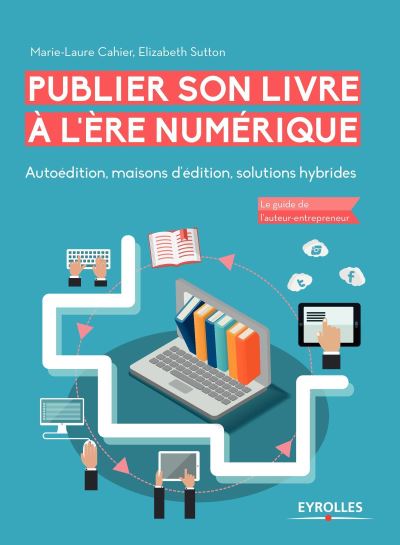EDLL aime réfléchir sur cet écosystème du livre qui lie auteurs, éditeurs, libraires et bibliothèques. Ses lecteurs savent que la révolution numérique est particulièrement complexe dans ce domaine. Le livre porteur de textes sert de média de diffusion depuis des millénaires, et se développe encore plus efficacement par Internet et le web depuis maintenant une génération.
Pour autant, le support papier est incroyablement résistant, car complètement indépendant de tout dispositif technique de restitution, à l’inverse de la musique ou de la vidéo. Bien qu’il ne soit plus incontournable, le livre papier offre une modalité de lecture qui conserve sa valeur, bien que celle-ci varie selon les sensibilités personnelles. EDLL, bien qu’étant à la base une maison d’édition numérique, fait aussi une part à la demande de papier.
La pression de l’open access
Selon l’adage, l’information “veut” devenir libre en circulant sur les réseaux. Les réseaux sont devenus l’idéal des bibliothèques, qui ont toujours prôné l’accès gratuit à l’information. Les bibliothèques soutiennent fortement, et naturellement, les mouvements open access, et bâtissent des bibliothèques numériques ou des serveurs d’archives institutionnelles de plus en plus riches.
L’open access est aussi une réaction justifiée contre les grands éditeurs scientifiques internationaux. Ils ont su capter les profits de l’explosion de la production d’articles au cours du 20e siècle, [1] puis consolider leurs marges bénéficiaires en négociant habilement le tournant numérique dans les années 1990. [2] Les particularités du système de communication scientifique et les enjeux considérables qui lui sont liés (réputation, évolution des carrières scientifiques, accès au financement pour la recherche) ont contribué à verrouiller ce système.
Il est devenu commode d’opposer les mondes de l’édition STM (Sciences, techniques et médecine) à celui de l’édition SHS (Sciences humaines et sociales): d’un côté quelques mastodontes ultra profitables, de l’autre un émiettement de structures de dimension modestes, souvent à la limite de la rentabilité. D’un côté une langue (l’anglais) et un marché global; de l’autre une diversité linguistique qui compartimente les publications sur des marchés régionaux. L’usage est majoritairement numérique d’un côté, encore largement imprimé de l’autre.
Concilier accessibilité et activité commerciale
L’existence des éditeurs SHS traditionnels dépend beaucoup des ventes physiques et se trouve particulièrement menacée par l’open access.
Deux études françaises complémentaires sorties en 2015 ont tenté de mesurer et d’expliciter la fragilité de ce secteur. Elles concernent avant tout le marché des revues – notamment celles hébergées sur la plate-forme Cairn – pour lequel une masse critique et un recul suffisants sont disponibles. Mais les résultats peuvent être sans problème étendus au marché des livres.
La première étude, conduite par l’Institut des politiques publiques de Paris [3], cherche à déterminer quelle est l’influence sur l’audience de la revue d’une politique d’open access, par rapport à des accès protégés par mot de passe pendant une période plus ou moins longue.
Pour tirer des revenus tout en préservant la diffusion physique imprimée, l’accès sur le portail doit être temporairement payant. Ce sont les organisations, bibliothèques académiques surtout, qui paient des abonnements pour l’ensemble de leur communauté. Hors de ce cercle limité, les institutions non affiliées, les chercheurs indépendants ou les simples citoyens n’ont pas du tout accès à ces contenus.
L’étude met en avant un constat prévisible: plus la durée de protection est courte, plus grande sera l’audience de la revue, considérée sur la longue durée. En revanche, et c’est là un élément plus intéressant de la conclusion, le point de basculement se situe à 12 mois. Un embargo supérieur à une année entraîne une diminution des consultations trop importante pour pouvoir être rattrapée au fil des années suivantes. Or la plupart des revues Cairn ont une barrière mobile fixée entre 3 et 5 ans…
La seconde étude [4] s’intéresse aux conséquences économiques d’une réduction de la durée d’embargo à un an maximum pour les sciences humaines, comme l’encourage la recommandation européenne de 2012 “relative à l’accès aux informations scientifiques et à leur conservation”. La perte de valeur est importante pour l’éditeur: elle est estimée à 20% pour les versions papier. Celles-ci perdent évidemment d’autant plus de valeur que leur contenu est accessible rapidement de façon gratuite.
Il est difficile de ne pas avoir de sympathie pour l’open access. Mais une politique affirmée dans cette direction ne fait pas bon ménage avec la survie financière des éditeurs SHS. L’étude recommande une phase de transition et un soutien financier des pouvoirs publics pour dédommager les éditeurs qui acceptent une faible durée de protection préalable à la gratuité.
L’expérimentation du Fonds national suisse de la recherche scientifique
En Suisse également les nouvelles contraintes réglementaires édictées en 2014 par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), principal bailleur de fonds publics, a soulevé un débat nourri dans le milieu des SHS. Comme en France et ailleurs en Europe, l’open access est considéré comme un principe pour assurer l’accès public des résultats de la recherche issue de ses subsides. Le FNS est d’ailleurs signataire depuis 2006 de la Déclaration de Berlin qui promeut le libre accès à la connaissance. Dans le règlement FNS, les articles doivent être disponibles au plus tard 6 mois après leur publication, au plus tard 24 mois pour les livres. Les frais de publication peuvent être inclus dans les demandes de subsides. Cette mesure annoncée en 2014 a suscité beaucoup d’émoi chez les éditeurs de sciences humaines. Ils jouent en effet un rôle indubitable dans la diffusion des résultats scientifiques au-delà des cercles académiques, élargissant à la sphère publique le débat d’idées. [5]
Plutôt qu’une simulation économique, la FNS a alors voulu procéder de façon expérimentale à un projet pilote d’édition de livres scientifique en libre accès: OAPEN-CH. Les conséquences de l’open access sur la publication y sont étudiées selon deux modèles: 1) des livres publiés simultanément en open access, sans délai d’embargo, et sous forme imprimée payante, 2) des livres disponibles en open access 24 mois après la première publication, mais restant payants sous forme imprimée. Les premiers livres tests sont parus fin 2015 et sont disponibles aussi bien chez les libraires que sur les serveurs de bibliothèques universitaires et dans un entrepôt européen de livres en open access (OApen Library).
L’inconvénient de cette approche est qu’il faudra patienter encore un moment pour en tirer des enseignements sur le marché de l’édition, et qu’entre-temps d’autres initiatives, impulsions ou réglementations continueront à orienter ou modifier les conditions de cette activité économique…
Aucune des études dont nous parlons ne remet en question la place de l’éditeur SHS dans le circuit de communication de la recherche. La valeur de son travail éditorial, indispensable pour amener un texte au public n’est pas contestée. L’éditeur commercial y est aussi souvent aussi l’éditeur scientifique, qui participe directement à la création de la publication.
Il y a là un contraste saisissant avec la façon dont travaillent les éditeurs STM, qui abusent de leur monopole et renvoient une image de prédateurs, acceptée uniquement parce que personne ne veut voir le système s’effondrer. Dans les domaines STM c’est la communauté des chercheurs (les “pairs”) qui fait le travail d’éditeur scientifique, l’éditeur commercial étant presque uniquement un intermédiaire. Il gère la diffusion des revues, et, en les traitant comme des “marques” incontournables, garantit ou développe encore leur valeur financière.
Dans les sciences humaines, il arrive que tout ce travail soit fait par l’auteur lui-même dans le cadre d’une auto-édition. Editeur scientifique, éditeur commercial, garant et vendeur de ses propres recherches… Est-ce vraiment son rôle et doit-il aussi en avoir la capacité.